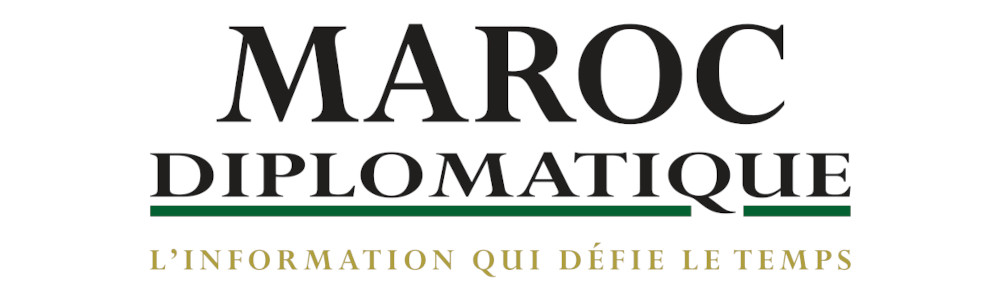Article paru dans Maroc Diplomatique le 20 janvier 2017
Le phénomène de coaching semble gagner du terrain ces dernières années et séduire de plus en plus les esprits. Selon vous, est-ce une tendance profonde qui s’enracine, un effet de mode importée ou un besoin réel inscrit dans la modernité dans une société en pleine explosion ?
Je crois constater comme vous que le coaching devient de plus en plus populaire. Il questionne. Il intrigue. Il séduit. Les réseaux sociaux et internet l’ont probablement rendu plus visible, plus accessible. En face, nombreux sont nos concitoyens qui s’interrogent. Ils ont des questions sur la vie, sur leur carrière, sur l’éducation des enfants, sur le bonheur, sur les relations amoureuses ou conjugales … Ce qui a peut-être changé ces vingt dernières années, c’est que le bonheur est devenu une quête indispensable. Je crois parfois voir un certain « terrorisme » du bonheur. Cela me rappelle mes années d’adolescence où le féminisme battait son plein. Une certaine forme de « terrorisme » féministe existait : une femme se devait être féministe. La société, ou du moins la gent féminine d’alors, n’acceptait pas et raillait les femmes qui posaient d’autres choix. C’était l’époque. Il se fallait être moderne. Aujourd’hui, c’est le bonheur. Or, à travers la publicité et les médias, il nous est offert une image déformée du bonheur. Les annonceurs s’investissent à nous convaincre au quotidien que le bonheur passe par la consommation. Pourtant, bien que nous consommions, beaucoup n’atteignent jamais le bonheur espéré. Dans l’esprit du grand public, le coaching est souvent au service de la quête du bonheur ou d’une certaine « normalité ».
Maintenant, pour me recentrer sur votre question, si le coaching devient plus visible, cela ne veut pas dire qu’il y a significativement plus de personnes qui fréquentent les professionnels. Une partie de la clientèle historiquement dévolue aux psychiatres migre vers certains coachs. C’est parfois dû à l’évolution des pratiques dans chacune de ces spécialités.
Une bonne partie de la visibilité qu’a le coaching aujourd’hui tient aux efforts marketing des écoles de coaching qui ont besoin de remplir leurs formations. Ils parlent de coaching et séduisent. J’ai parfois l’impression que les seuls à véritablement bien vivre du coaching, ce sont les écoles. Sur base d’un calcul simple et très approximatif, j’ai estimé un jour que la seule place de Casablanca « mettait sur le marché » environ six cents nouveaux coachs par an. C’est beaucoup. Rares sont ceux qui arrivent à percer dans le métier et à en vivre.
Une autre part significative de la visibilité est offerte par les jeunes coachs qui utilisent les réseaux et internet pour se faire connaître en exposant leur savoir et savoir-faire supposés. Souvent l’exposé de la théorie masque l’absence d’expérience ou de réflexion propre.
Je me dois peut-être aussi d’apporter un bémol à ce que j’avance ici. La plus jeune génération (la génération dite Y) est aussi grande consommatrice de coaching. Elle a grandi avec. Les coachs et le coaching ont investi les Grandes Écoles et les Universités. J’observe que les modes de fonctionnement de cette plus jeune génération, qui s’interroge beaucoup et qui se sent parfois (souvent ?) en perte de repères, repose beaucoup sur une recherche rapide d’information fiable. C’est que qu’offrent les coachs dans leurs conférences, leurs capsules vidéos ou leurs posts.
L’objectif étant le bien-être et la sérénité, pensez-vous que le coaching pourrait constituer une solution efficace pour nous délivrer ou guérir du stress et nous proposer une méthode d’accompagnement vers le bien-vivre ?
Le coaching n’a pas pour objectif le bien-être ou la sérénité, même s’il peut y contribuer. Et puis, nous pourrions philosopher ensemble pour savoir s’il s’agit bien là d’un objectif sain, voire d’un objectif. Le coaching est un accompagnement offert aux personnes qui consultent pour les aider à trouver leurs propres réponses ou solutions à des questions qu’ils se posent ou des problèmes auxquels ils se sentent confrontés. Le gros avantage de la démarche de coaching est qu’elle responsabilise le client. En cas de besoin, elle l’invite à reprendre possession de ses responsabilités. Elle met le client au centre de la problématique et l’accompagne à trouver des solutions en lui et non, de façon utopique, à l’extérieur de lui, dans un grand respect de lui et des autres. Le coach accompagne son client dans son ascension vers le niveau supérieur.
Pour moi, la mission d’un coach est de remettre le plus rapidement possible son client en autonomie et en action. C’est dire l’aspect anti-économique de la démarche et du métier. Maintenant, en imaginant que la personne qui consulte vise le bien-être ou la sérénité, alors oui, je pense que le coaching peut être une bonne démarche pour les conquérir.
En même temps, d’autres approches valables centrées sur le développement personnel ou la spiritualité existent aussi (et parfois depuis bien plus longtemps que le coaching). Elles offrent les mêmes bénéfices.
Il existe de plus en plus une diversité de coaching : professionnel, individuel, collectif, d’entreprise et philosophique. Comment une société comme la nôtre, mélange de tradition et d’exigence moderniste affichée peut-elle intégrer ce mode d’épanouissement sans s’exposer ?
Il y a trois aspects important dans votre question. Le premier, c’est que le coaching n’est pas une fin en soi. Si le coaching peut trouver sa place dans tous les contextes (professionnel, personnel, sportif …), je trouve qu’il est immature et irresponsable de prétendre qu’un même coach puisse être efficace et performant dans tous ces domaines. Pour moi, le coaching est un outil qui vient au service d’une spécialité. En ce qui me concerne, je me définis plutôt comme un coach professionnel, c’est-à-dire un coach qui place son action dans le monde économique. En même temps, j’ai trente ans de carrière professionnelle derrière moi. Trente ans d’une carrière internationale dense consacrée à dispenser du conseil et de la formation à très haut niveau au sein des entreprises, des PME et des multinationales. J’ai d’ailleurs développé mes talents de coachs dans le cadre des missions centrées sur la conduite du changement et l’amélioration des performances opérationnelles et commerciales de ces organisations. Jamais il n’est possible d’atteindre des objectifs aussi ambitieux en forçant les gens. Il nous faut donc les accompagner, cultiver leur envie de changer parce que c’est ce qu’ils perçoivent comme bon pour eux. J’ai donc exercé un métier qui a mis très très tôt l’humain au centre de mes préoccupations. Avec les décennies, je pense avoir acquis une connaissance très intime de l’être humain et de ses modes de fonctionnement. En formalisant la démarche de coaching, je ne fais que la mettre au service d’une spécialité déjà bien établie. Je tire moins ma crédibilité professionnelle de mon statut de coach que de ma maîtrise de la conduite des entreprises, ou des organisations de travail au sens large.
J’observe que beaucoup de jeunes sont séduits par le métier et vont se former dans les diverses écoles de coaching. Je trouve cela formidable qu’ils s’intéressent si tôt à la découverte de l’être humain, et je ne peux que les encourager à continuer. En même temps, je pense aussi qu’il est souvent trop tôt pour eux pour entrer dans le métier. Je pense qu’ils gagneraient à développer une véritable expertise et maturité professionnelle au service desquelles il pourra mettre un jour la démarche de coaching. Le coaching viendra alors enrichir ce qu’ils ont a offrir et élargira le champ de leurs possibilités d’action.
Le second aspect de votre question est l’opposition entre modernisme et tradition. Je ne définis pas nécessairement le Maroc comme un pays musulman. Je pense qu’il est traditionnellement peut-être plus que cela. Je le définis plus volontiers comme un pays aux racines soufies. L’histoire a voulu qu’éclosent et que se maintiennent à travers les siècles bon nombre de confréries, confréries qui comptaient en leur seing de grands hommes. Socialement, quel pouvait être souvent le rôle des soufis ? J’émets l’hypothèse qu’ils devaient être un peu les psychologues ou les coachs de l’époque. Ceux qui étaient confrontés à des difficultés de la vie les consultaient, et les sages apportaient de l’apaisement en les aidant à tirer du sens de leurs épreuves. Je pense que de tout temps, l’homme a eu besoin de faire appels aux autres, aux plus sages, aux aînés. Bref, à ceux qui, par leur sagesse ou leur ancienneté, avaient développé une connaissance plus intime de l’être humain.
Dans le monde moderne, le psychiatre ou le coach ont fait de l’humain leur spécialité. Certains sont brillants. En même temps, nombreux sont encore nos concitoyens qui consultent les fqihs. Après, choisir voir l’un ou l’autre dépend probablement de sa vision du monde, de son approche des réalités, de l’état de ses croyances ou de la force ses présupposés.
Le troisième aspect que soulève la question est la confusion qui est faite de la finalité d’un coach. Un coach n’est pas là pour apporter des réponses, mais pour permettre à quiconque (individu ou groupe) de trouver les siennes. Dans les assemblées, un coach pourrait avoir comme contribution de prévenir les pièges de l’esprit, aidant par là-même les personnes qui échangeraient autour de questions philosophiques ou politiques d’aller plus loin.
Un phénomène ressort immédiatement de cette nouvelle pratique : les femmes constituent une forte majorité des coachs. Comment l’expliquer ?
J’observe que les femmes ont souvent l’intelligence émotionnelle plus développée. Elles sont plus à l’aise avec les émotions. Peut-être que certaines traditions encore vivaces, traditions qui veulent qu’on nie peu ou prou le droit aux garçons d’investir le champ des émotions, fait que la gent féminine est mieux préparée et disposée à ces métiers. De plus, ce sont des métiers centrés sur ce qu’on appelle la relation d’aide. À nouveau, la tradition a plus tendance à maintenir les garçons dans le champ de la compétition, même s’il faut reconnaître que les choses changent.
Maintenant, si on peut observer qu’il y a plus de femmes dans le métier, cela ne veut pas dire pour autant qu’elles sont meilleures. Être une femme n’est pas un gage de qualité professionnelle. Tout dépend de sa capacité réelle à prendre la distance qui me paraît nécessaire à la bonne pratique du métier. Il en va de même pour leurs collègues masculins bien sûr. Évidemment, et j’en connais et les respecte, il y a aussi beaucoup de femmes formidables dans le métier.
Y a‑t-il un coaching pour les démunis, autrement solidaire qui prend en charge les marginaux et un autre pour les riches qui sont en quête de bien-être payant ?
Je connais quelques très beaux coachs qui offrent, sous une forme ou une autre, du coaching social. Évidemment, c’est parce qu’il y a des clients qui peuvent payer le prix affiché que ces coachs peuvent mettre au service de plus démunis leurs talents uniques. Lorsque vous êtes un jeune coach qui doit encore bâtir sa réputation et sa clientèle, bien souvent chaque client compte, car il y a par exemple les frais fixes du cabinet à couvrir. Ils sont donc plus rares à entrer dans cette démarche. Mais ce n’est pas exclu.
Maintenant, si on regarde du côté d’actions qui seraient plus institutionnalisées, je n’en connais pas. Peut-être existent-elles. Simplement, je ne les ai jamais croisées. Elles échappent à mon radar.
On assiste au développement de cette discipline au sein de l’entreprise, car les dirigeants ne sont plus les bénéficiaires exclusifs, mais aussi les employés ?
Si la pratique est bien implantée dans le monde anglo-saxon, et de façon plus large dans le monde industrialisé, il me semble encore émergeant au Maroc. Je vois plusieurs raisons à cela. Tout d’abord le manque de crédibilité dont souffre parfois le métier. L’inexpérience ou la jeunesse de certains qui s’improvisent coach professionnel refroidit parfois les entreprises. Une mauvaise expérience, surtout si c’est la première, peut sonner le glas du coaching dans l’entreprise. L’incapacité aussi d’un certain nombre de coachs, même plus confirmés, à pouvoir tenir un langage d’entreprise et à placer leur démarche dans la logique qui est au cœur des habitudes économiques. Par exemple, rares sont les coachs d’accords ou capables d’aborder la question du retour sur investissement. Cela n’est pas de nature à rassurer les entreprises, ni à les aider à mieux mesurer l’impact du coaching sur l’évolution des performances économiques. Au prix du coaching professionnel, comment justifier la dépense à son conseil d’administration si on ne peut l’accompagner de la mesure des retombées positives ?
Le tissu économique marocain est essentiellement composé de petites entreprises. Or j’observe que ces dernières ont une certaine aversion à investir dans le développement de leurs collaborateurs. « Exit » donc la formation ou le coaching.
Le manque de fidélité du personnel décourage aussi les patrons à investir dans son développement.
À l’inverse, certaines structures, plus importantes et organisées, commencent à avoir régulièrement recours au coaching, car le besoin se fait de plus en plus pressant. La « Génération Y » prend de plus en plus de place dans les grandes entreprises. Certaines ont déjà plus d’un tiers de leur effectif issu de cette génération. Or, c’est une génération qui se montre plutôt infidèle à l’entreprise. C’est une génération qui se caractérise par sa mobilité. Les entreprises tentent donc par tous les moyens de les conserver. Or, une des obsessions cette génération, c’est son employabilité. Lorsque les statistiques vous prédisent que vous changerez en moyenne quinze fois d’employeur au cours de votre carrière, rester dans la course devient une nécessité.
Dans ce contexte, le coach se substitue souvent au manager en carence. C’est en principe le rôle d’un manager que de se soucier au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Malheureusement, il y a au sein de nos organisations carence en management. Le coach pallie donc souvent à l’incompétence ou la désertion managériale.
Dans quelle mesure le coaching peut-il concurrencer la psychanalyse et pourrait-il à terme s’y substituer ?
Difficile de répondre à cette question. Dans certains pays, comme au Canada par exemple, les psychanalystes et les psychologues se sont battus pour faire reconnaître leurs métiers et pour les protéger. C’est ainsi qu’une nomenclature s’est mise en place, nomenclature qui reprend les pathologies et les actes ne pouvant être posés que par un psychologue ou un psychiatre. La guerre est donc déclarée.
En même temps, je peux comprendre, car alors que ces professionnels ont derrière eux tout un parcours universitaire significatif, beaucoup de coachs n’ont qu’une formation courte (quelques jours à quelques semaines) sanctionnée par un certificat rarement reconnu et signifiant. Au Maroc, le coaching n’est pas une profession reconnue ou réglementée. Celui qui le veut peut poser une plaque sur son porche et se déclarer coach. Je pense qu’il y a des choses qu’on doit laisser à des professionnels qui comprennent de quoi il s’agit. Il est à nouveau question ici de savoir au service de quelle spécialité chacun met la démarche de coaching. Le coaching n’est pas une fin en soi. Par exemple, en coaching, beaucoup utilisent les outils de la PNL, de l’Analyse Transactionnelle ou de l’Hypnose. Ce ne sont que des outils. Des outils mis au service d’une démarche avec le client. Même si je maîtrise l’hypnose, je ne me vois pas me définir comme un hypnothérapeute, car je ne connais rien aux pathologies. Je ne me vois pas aborder un schizophrène ou un bipolaire. Ce n’est pas mon métier. Je n’ai pas le background pour cela. Par contre, l’hypnose est pour moi un outil formidable que je mets au service de mon background, c’est-à-dire l’accompagnement des entreprises, le développement des performances ou le développement personnel.
Au Maroc, le métier n’est pas organisé ce qui se répercute de manière négative sur le client. Comment peut-on mettre fin à ce danger ?
Je pense qu’il faut nuancer. Au Maroc, le métier n’est pas organisé, c’est vrai, ce qui peut, en certaines circonstances, se répercuter de manière négative sur le client.
Ceci étant dit, observons que certains coachs, parfois déjà bien établis et jouissant d’une bonne réputation, désirent préserver le métier en en protégeant sa réputation. Cela passe entre-autre par le fait de préserver la qualité des relations et des prestations. La tentation est donc forte de vouloir mettre des barrières à l’entrée afin d’exiger de ceux qui veulent se prétendre coach d’être en capacité de pratiquer le métier dans les règles supposées de l’art.
Cela passe aussi par le fait d’avoir une offre claire en réponse à des attentes claires. Malheureusement la démarche de coaching souffre de beaucoup de confusion dans l’esprit du grand public, ce qui génère chez lui des attentes déraisonnables, ou peu en phase avec ce que le coaching a vraiment à leur offrir. Ce ne sont pas les coachs qui sont à l’origine de cette confusion, mais bien plutôt le monde des médias et du spectacle qui présente des « coachs » à la télévision ou à la radio, « coachs » qui, dans la prestation qui leur est demandée, ne sont pas en posture de coach, mais habituellement en posture de conseil.
Ces différentes choses, et d’autres encore, concourent à vouloir réglementer le métier, ce qui peut paraître légitime. La difficulté, de ce que j’observe au Maroc, c’est que plusieurs initiatives sont portées par différentes écoles, chacune souhaitant probablement voir se généraliser la sienne. C’est vrai qu’entre certaines écoles, la vision de la pratique ou du métier présentent parfois des différences qui sont loin d’être anecdotiques. Donc, au lieu de se rassembler et s’entendre, il me semble que nous assistons à une guerre de clochers. Évidemment, ce n’est pas parce qu’on est coach qu’on est nécessairement sage.
Maintenant, faut-il réglementer ? S’il peut y avoir du pour, comme on le comprend de ce qui précède, je pense que réglementer peut être aussi les prémices d’une mort annoncée du métier. J’observe que les plus grands contributeurs, ceux qui nous ont offerts ces formidables outils avec lesquels nous travaillons, ne sont pas nécessairement certifiés. Notre pratique existerait-elle sans un Robert Dilts, un Stephen Gilligan, un Richard Bandler, un Milton Erickson, pour n’en citer que quelques-uns ? Je ne crois pas. Or, ce qui caractérise ces personnes, c’est leur inventivité, leur goût pour l’expérimentation, leur liberté de penser ou de transgresser les règles établies (parfois par eux-mêmes). Ce qu’il faut comprendre, c’est que nos outils ont souvent un seul objectif : aider ceux qui nous consultent à dépasser leurs résistances pour se voir offrir une vraie chance de pouvoir, par eux-mêmes, opérer les transformations qu’ils recherchent. En fait, un coach ne fait souvent que mettre la personne en capacité à changer. Il est dit souvent dans le métier que le client est « son propre thérapeute ». Comme nous l’avons évoqué plus haut, les outils que nous utilisons pour cela sont aujourd’hui bien souvent galvaudés. Ils sont largement exposés et partagés sur internet. Certains autodidactes développent leur maîtrise des outils pour « jouer », et ce sans déontologie ni respect à l’égard de leurs victimes. Avec le temps, tous ces outils qui avaient pour but d’aider nos clients à contourner leur résistance deviennent inopérants. Si vous savez par quel chemin je vais « passer », où pensez-vous que vous allez poster votre résistance ? Sur le chemin que je vais emprunter. Donc, à terme, nous pourrions rapidement nous trouver démunis. Si nous perdons la capacité à renouveler nos outils, c’est la mort du métier à terme. Ma crainte est qu’une réglementation contraigne les praticiens à rester dans le cadre d’une orthodoxie qui sera définie. Nous perdrions au passage le droit à l’expérimentation ou à la personnalisation de la pratique.
Pourquoi parle-t-on de client et non pas de patient ?
Peut-être parce que nous ne sommes pas censés faire de la thérapie. Ayons conscience que psychiatre et coachs peuvent partager les mêmes outils. La PNL, l’Analyse Transactionnelle ou l’Hypnose que nous avons évoquées plus haut, ne sont pas l’apanage des coachs. Ce sont des outils et des pratiques qui ont leur racines dans le champ de la psychologie. Si c’est un psychiatre qui met en œuvre la démarche de coaching dans un cadre thérapeutique, il sera légitime qu’il appelle celui qui le consulte un patient.
Quels sont les enjeux et les limites du coaching ?
Question difficile, tant les contextes peuvent être à ce point variés. Il me semble que beaucoup s’entendent sur le fait que le coaching est une démarche centrée sur celui qui consulte. C’est l’accompagnement d’un travail intérieur, travail qui peut être au service d’objectifs variés et divers. L’idée communément admise est que les solutions sont à trouver à l’intérieur de soi. Comme il est impossible de changer ce qui est à l’extérieur de soi, et encore moins les autres, tout ce qui peut être fait, c’est de changer ce qui est à l’intérieur de soi ou de se changer soi. Cela consiste souvent à mobiliser ou acquérir de nouvelles ressources ou à transposer des ressources existantes dans de nouveaux contextes.
Quant aux limites, il y en a une qui me paraît très évidente : la volonté de celui qui consulte d’entrer dans la démarche et de développer les efforts nécessaires au changement. Le coaching est, et reste, une relation librement consentie. Si celui qui consulte ne veut rien faire, s’il refuse d’agir, alors rien ne changera. C’est pourquoi beaucoup de coach soutiennent, probablement à raison, qu’ils n’ont qu’une obligation de moyen. Ils ne peuvent être responsables du résultat. D’ailleurs, à contrario, ils ne devraient jamais s’approprier les résultats.